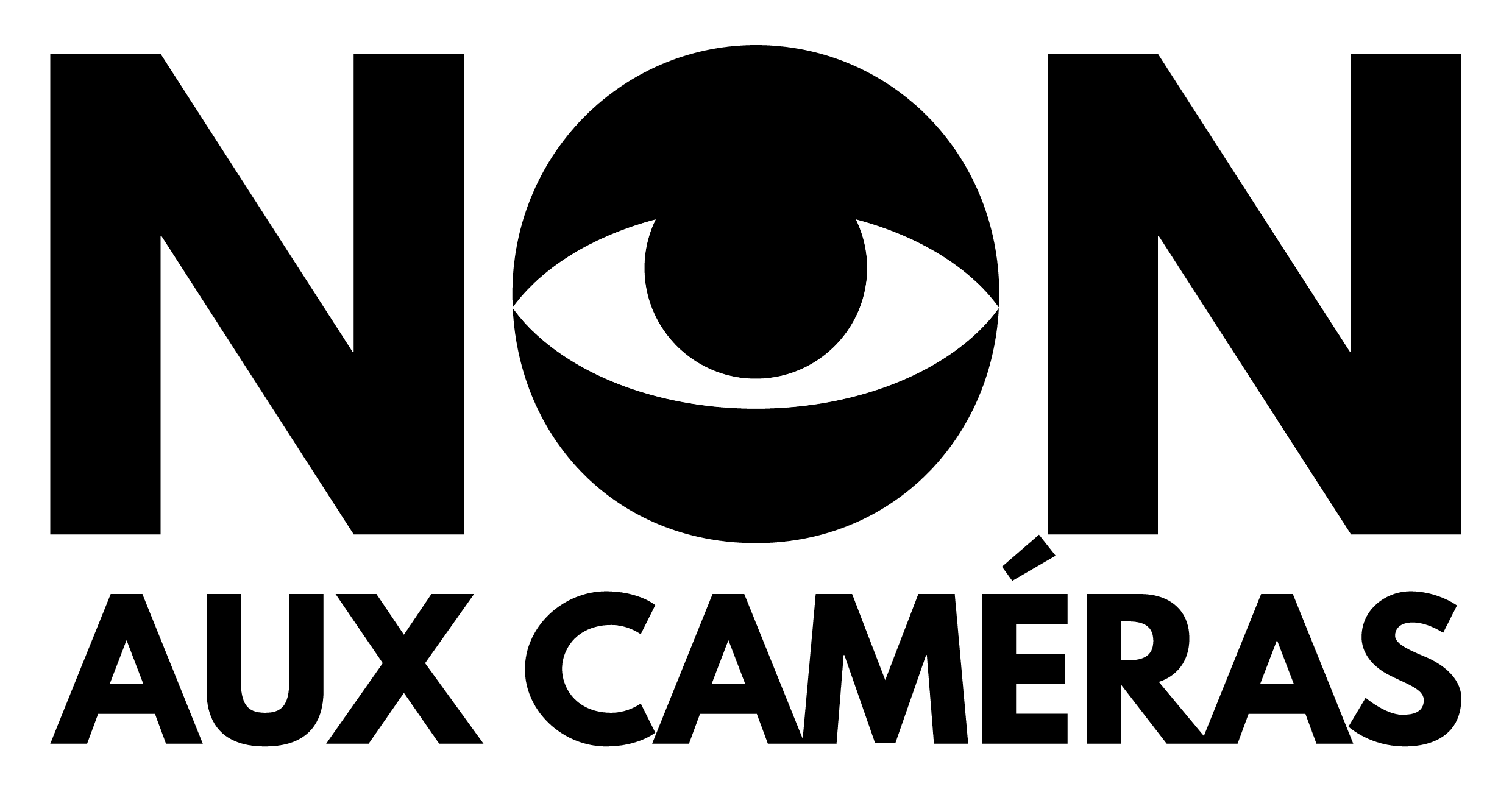Le 29 juin, la population veveysanne devra se prononcer sur le projet de la Municipalité de Vevey, qui propose de dépenser un budget considérable pour installer 44 caméras de vidéosurveillance sur 75’000 m2 afin de lutter contre le sentiment d’insécurité associé au deal de rue autour de la gare.
En mettant sous surveillance vidéo un large périmètre d’espace public autour de la gare de Vevey, la Municipalité prétend mettre fin ou réduire le trafic de stupéfiants et répondre au sentiment d’insécurité qu’il suscite. Réalistement, elle ne peut pas atteindre ces buts, malgré l’importance des dépenses proposées. Pire, la vidéosurveillance risque d’aggraver la situation.
Vidéosurveillance: illusoire assurance
Une mesure comme la vidéosurveillance ne peut avoir un effet dissuasif qu’envers une délinquance qui calcule les risques de se faire prendre, comme un cambrioleur ou un voleur de voiture.
Des actes non prémédités, impulsifs, comme des agressions ou des bagarres, sous l’effet de la colère ou de l’alcool, ne sont pas sensibles à la dissuasion. Or la peur de ces actes, heureusement rares, contribue au sentiment d’insécurité que peut ressentir une partie de la population, et pas uniquement autour de la gare. La vidéosurveillance de ce secteur ne dissuaderait pas ces actes et ne diminuerait donc pas le sentiment d’insécurité.
De plus, la création d’une zone sous surveillance, avec ses 85 panneaux d’avertissement légalement obligatoires, serait au contraire source d’inquiétude pour bien des gens.
Le cas particulier du commerce de stupéfiants pose un autre problème : les caméras de surveillance, même en haute définition, montreraient au mieux une personne donnant quelque chose de non identifiable à une autre. De telles images ne pourraient guère servir de preuve, comme indiqué par la police d’Yverdon à la RTS (« Vidéosurveillance et deal de rue : le bilan contrasté d’Yverdon », 12 février 2025), quand bien même une instruction pénale serait ouverte dans les sept jours après les faits. Les dealers sont parfaitement au courant de ces faits, notamment parce qu’à Yverdon la vidéosurveillance est en échec depuis 2009 ; tout comme elle est en échec dans le quartier des Pâquis, à Genève (voir Evaluation de l’efficacité de la vidéosurveillance / vidéoprotection aux Pâquis – 2014-2016, Prof Francisco Klauser et Dr Raoul Kaenzig, Université de Neuchâtel, Institut de géographie, 2016).
La vidéosurveillance n’aurait donc qu’une influence limitée sur la présence des trafiquants de stupéfiants, et sur le sentiment d’insécurité.
« Toutes les études, y compris internationales, s’accordent sur le fait que la vidéosurveillance ne dissuade pas. […] Les délinquants peuvent s’adapter à cette menace potentielle mais ils ne seront jamais dissuadés par la seule présence de caméras, c’est un fantasme que l’on peut balayer. »
Guillaume Gormand, chercheur, Le Monde, 22 décembre 2021, à propos de son étude réalisée pour la gendarmerie française
Pas de visionnement en direct
Il n’y aura pas à Vevey un mur d’écrans scrutés par des policiers prêts à déclencher une intervention immédiate sur le terrain. En effet, la loi vaudoise sur la protection des données personnelles n’autorise pas le visionnage en direct des images. Cette interdiction est reprise dans le règlement de l’Association Sécurité Riviera (ASR), qui serait chargée de l’exploitation des images ; l’ASR considère par ailleurs qu’une telle surveillance en continu est impossible, quelles que soient les conditions légales, car elle nécessiterait trop de personnel et coûterait bien trop cher.
Le deal se déplace, les caméras restent
Le projet de la municipalité serait l’une des plus grandes installations de vidéosurveillance de l’espace public du Canton de Vaud avec une surface totale annoncée de 75’000 m2. Mais, au lieu de résoudre le problème, la vidéosurveillance risque de le disperser, car, s’ils devaient s’inquiéter d’être filmés, les vendeurs et les consommateurs déplaceraient leurs activités de
quelques dizaines de mètres pour continuer leurs affaires comme actuellement. La zone immédiatement adjacente à celle surveillée selon le projet regorge en ef fet de cours, halls d’immeubles, rues passantes, etc. qui pourraient tout aussi bien accueillir leur trafic.
Un tel déplacement, dans n’importe quelle direction, rapprocherait inévitablement la zone de deal d’écoles et de quartiers où de nombreuses familles habitent. Ce n’est pas une hypothèse en l’air : à la suite de précédentes opérations policières, le commerce de stupéfiants, organisé derrière la gare dans les années 1990, s’est déplacé autour du rond-point à l’entrée ouest de la ville, et aujourd’hui autour de la gare à nouveau. C’est exactement l’expérience qui est faite depuis plusieurs années dans le quartier des Pâquis à Genève, où le deal s’est installé devant une école.
La gare génère du passage à toute heure ; les risques de débordements graves y sont donc moindres que dans des zones avec moins d’activité. La dispersion du deal dans les quartiers alentour conduirait à une aggravation du problème que le projet de vidéosurveillance prétend résoudre.
Des coûts disproportionnés
Le 29 juin, la municipalité demande à la population de lui accorder un crédit de près de 900’000 fr., dont l’essentiel (près de 700’000 fr.) est consacré à la vidéosurveillance (voir encadré « combien ça coûte vraiment ? »). Ce que nous contestons, c’est uniquement ce projet de vidéosurveillance, la dépense immédiate de près de 700’000 fr. et les coûts annuels (entretien et amortissement) de près de 100’000 fr. qu’il implique.
Alors que les budgets se resserrent, menaçant des services essentiels pour la population, est-il vraiment raisonnable de dépenser autant pour une réponse que nous savons déjà inefficace ? Cet argent ne pourrait-il pas être mieux utilisé en renforçant les autres volets du projet ?
Il faut aussi prendre en compte le coût environnemental qu’implique l’utilisation de ce matériel technologique (caméras, transmission et stockage d’un considérable volume de données), sa consommation électrique, son remplacement fréquent et les déchets ainsi générés.
Combien ça coûte vraiment ?
Le titre du préavis 03/2025 qui est soumis au vote est : « Demande d’un crédit d’investissement de 799’700 fr. pour l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, d’un crédit supplémentaire déjà dépensé au budget 2024 de 96’600 fr. et d’accepter la mise en œuvre de mesures complémentaires ». Le montant total demandé est donc de 896’300 fr.
Le détail du crédit demandé figure dans la brochure de vote de la municipalité. On peut y constater que, de la fourniture des caméras et du logiciel de gestion au « plan de communication vidéosurveillance », des réseaux à créer ou à adapter à la « signalétique pour zones vidéosurveillées » toutes les dépenses prévues sont liées à la vidéosurveillance et à rien d’autre, à l’exception du « remplacement des luminaires », chiffré à 220’000 fr.
Nous ne nous opposons pas à cette dernière dépense, qui aura un réel effet pour diminuer le sentiment d’insécurité. C’est pourquoi nous affirmons que le coût de l’installation de la vidéosurveillance est de près de 700’000 fr. (exactement 676’300 fr.)
Mais le montant demandé reste impressionnant, même pour les partisans de la vidéosurveillance. La Municipalité cherche à le rendre plus acceptable, en publiant d’autres chiffres, bien inférieurs : le 4 mars 2025, elle écrit : « Est-il exact que l’installation des caméras coûtera 800’000 fr. ? Non. La fourniture et l’installation des caméras ainsi que d’un serveur dédié s’élèvent à 145’000 fr. ».
Puis le 29 avril, elle communique que « l’investissement prévu, hors éclairage public, n’est pas de 700’000 fr. mais de 245’000 fr. pour l’équipement de la vidéosurveillance, plus 96’000 fr. déjà investis dans l’élaboration et le chiffrage du projet selon une analyse de terrain. » Alors, 145’000 ? 245’000 ? 341’000 ? Ces chiffres variables ne sont pas sérieux.
La vidéosurveillance a un coût immédiat de 676’300 fr., plus une dépense annuelle, entretien et amortissement, de 100’000 fr. environ. C’est cela que le Comité « NON aux caméras » vous invite à refuser.
Caméras déjà présentes ?
Les CFF ont déjà installé depuis longtemps de la vidéosurveillance qui filme en permanence la population sans son consentement. Cela correspond à des dispositions du droit fédéral et à des logiques de protection particulières, qui ne peuvent ni ne doivent être transposées à l’espace public, lieu de liberté.
Et surtout, tout le monde peut constater que la revente de drogues se poursuit sans stress sous l’œil de ces caméras.
Les caméras, sinon rien ?
Les conclusions du préavis chargent aussi la Municipalité d’inscrire au budget 2026 le travail social de proximité et les frais de formation du personnel communal qui est au contact du public.
Les partis favorables au OUI tentent de faire croire que la mise en œuvre des « mesures complémentaires » et de l’observatoire de l’espace public mentionnées par le préavis dépendent du résultat du vote.
C’est faux. Les décisions concernant le budget 2026 seront prises par le Conseil communal en décembre 2025, indépendamment du vote du 29 juin.
Notre opposition ne porte que sur les caméras. Comme la Municipalité, comme tous les groupes qui se sont exprimés, nous sommes favorables aux « mesures complémentaires ». Il serait logique et normal que la Municipalité inscrive ces dépenses dans son projet de budget 2026, et que le Conseil communal les approuve, quel que soit le résultat du vote le 29 juin.
Droit fondamental en cause
À Vevey, il est impossible d’éviter la zone proposée à la surveillance, que ce soit pour passer d’un quartier à l’autre, pour se rendre à la Poste ou dans de nombreux commerces, ou pour utiliser les transports en commun. Cette zone est au cœur de la ville. C’est donc bien l’ensemble de la population de Vevey, les personnes venant y travailler ou celles de passage, qui seraient considérées comme suspectes et surveillées dans l’espace public par un système vidéo en haute définition, fixe et définitif. Tout cela pour un effet discutable, voire nul, sur les problèmes visés.
La protection de la vie privée est essentielle pour une démocratie dynamique et sereine, c’est pourquoi elle est garantie comme un droit fondamental par nos constitutions cantonale et fédérale. Surveiller l’espace public remet en question ce droit fondamental. Ce ne serait admissible que pour atteindre un but d’intérêt public supérieur et incontestable. Ce n’est ici pas le cas.
Les caméras actuellement disponibles et leurs logiciels incluent déjà des possibilités de surveillance intrusives (par exemple la reconnaissance faciale ou la prédiction des comportements). Pour l’heure, le cadre légal est – fort heureusement – clair et contraignant et protège nos vies privées. Mais le préavis prévoit déjà le renouvellement des caméras après la fin de leur garantie, au bout de cinq ans, et un remplacement certain au bout de dix à quinze ans.Il ne s’agit donc pas d’un projet de court terme. Une fois les caméras installées, elles resteront. Or ces lois protectrices peuvent changer, et la tendance générale, en Suisse comme ailleurs, n’est pas à leur renforcement. Les garanties d’aujourd’hui n’existeront peut-être pas demain. Et l’expérience atteste que lorsqu’un moyen technique est à disposition, il finit par être utilisé, même au-delà des intentions de départ.
Demain la reconnaissance faciale
Selon les informations révélées par la presse en avril, l’aéroport de Genève développe un projet de reconnaissance faciale par vidéo, dans le but déclaré de fluidifier les contrôles et renforcer la sécurité. Afin de « simplifier le parcours des passagers », leurs visages se-
raient enregistrés et serviraient de boarding pass.
Le dispositif technique est là, prêt à l’emploi. Dès lors que la loi serait modifiée dans ce sens, qu’est-ce qui empêcherait que la reconnaissance faciale soit utilisée en d’autres lieux, publics ou privés ? Les caméras sont le premier maillon d’une chaîne qui mène à la reconnaissance faciale. Sans caméras, pas de surveillance de masse de l’espace public.
Place de la Gare ou caméras ? Collision de projets
Depuis 2023, un long et complexe processus d’études urbanistiques destinées à la refonte complète et nécessaire du secteur de la Gare est engagé. Il est inclus dans le « Plan d’agglomération Rivelac », qui serait financé à hauteur de 30 à 40% par la Confédération. Ce projet permettra enfin de résoudre de nombreux problèmes auxquels notre actuelle place de la Gare est confrontée. Pour en savoir plus sur ce sujet, consulter le site demain.vevey.ch
Toutefois, pour que l’aide fédérale puisse être attribuée, les travaux doivent impérativement débuter entre 2028 et 2032. Les délais sont serrés et il faut les tenir, car une telle occasion d’améliorer ce lieu ne se représentera pas de sitôt. Toute contrainte logistique pérenne ajoutée à ce projet déjà très complexe, comme une vidéosurveillance, serait un risque de le faire échouer.
Ce réaménagement changera complètement la place, avec des arrêts de bus déplacés, des arbres plantés, les cheminements modifiés… Une vidéosurveillance conçue et autorisée pour l’actuelle place de la Gare deviendrait complètement caduque. Il faudrait la démonter et recommencer depuis le début tout le processus visant à la réinstaller dans la nouvelle configuration, après les travaux.
Le crédit pour installer la vidéosurveillance sur ce secteur aurait alors été dépensé pour rien. Une raison de plus de voter NON.
Aller plus loin
Médias
Consulter notre page On parle des caméras pour retrouver notre revue de presse.
études sur l’efficacité de la vidéosurveillance
Guillaume Gormand. Evaluation de la contribution de la vidéoprotection de voie publique à l’élucidation des enquêtes judiciaires. Etude CREOGN n°31300102, Sciences po Grenoble. 2021. ⟨hal-04875204⟩
Piza, E., Welsh, B., Farrington, D. and Thomas, A. (2019). CCTV Surveillance for Crime
Prevention: A 40-Year Systematic Review with Meta-Analysis. Criminology & Public Policy,
18(1): 135-159.